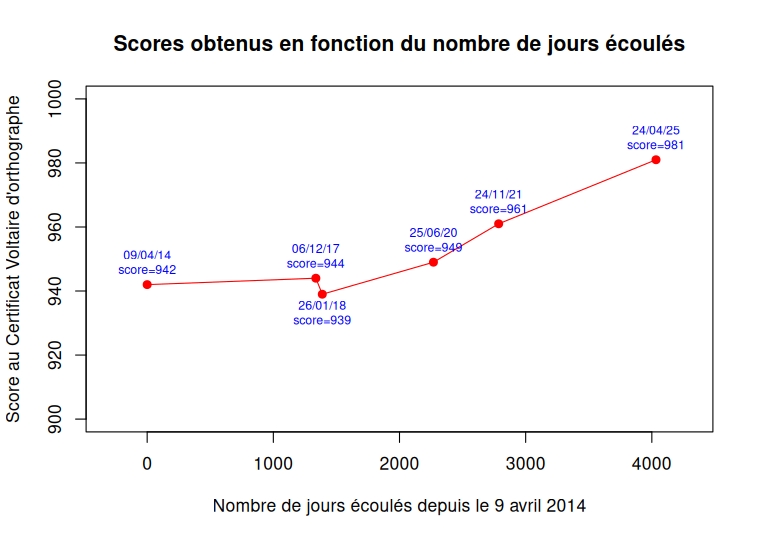Première mise en ligne : 6 février 2022 ; mise à jour : 25 octobre 2025.
C’est en quelque sorte l’informatique qui m’a formé aux mathématiques, puisque j’ai été en contact dès 1983 avec un Apple ][ Plus. J’y ai programmé en Basic, Logo, Pascal, et Assembleur 6502, au moyen duquel j’avais par exemple programmé (et non pas « implémenté » : voir plus bas…) le « mode insertion » tel que nous le connaissons aujourd’hui dans toutes les zones invitant à saisir du texte au clavier, mais qui n’existait alors pas sur l’Apple ][ Plus.
Mes parents ont échangé cet Apple ][ Plus contre un Macintosh LC, au début des années 1990 lors d’une opération de reprise, à l’occasion du dixième anniversaire d’Apple France (créée en 1981). Alors en DEUG A, je me suis passionné pour l’intelligence artificielle et les systèmes experts. Mes lectures préférées ont alors été, entre autres :
- Michel Gondran, Introduction aux systèmes experts, Eyrolles, 1983.
- Jean Friant et Yvon L’Hospitalier, Jeux – problèmes : de la logique à l’intelligence artificielle, Les Éditions d’organisation, 1986.
- Elaine Rich, Intelligence artificielle, Manuels informatiques Masson, 1987.
- Brian Sawyer, Denis L. Foster, Programmation des systèmes experts en Pascal, Manuels informatiques Masson, 1998.
J’ai programmé un tel « système expert en Pascal » en diagnostic financier qui a été mis en œuvre par Jean-Guy Degos, dans sa thèse de Doctorat d’État intitulée Contribution à l’étude du diagnostic financier dans les petites et moyennes entreprises.
En 1993, ce fut le tournant : licence de mathématiques, ou licence d’informatique ? J’ai fait le premier choix en raison de la plus grande pérennité des savoirs élaborés par les mathématiciens, à comparer à l’obsolescence technologique rapide, que j’avais déjà, à 21 ans, eu l’occasion de constater. Et je ne le regrette pas.
D’ailleurs, si l’on en croit Marie-Thérèse Bertini, auteur de La normalisation du logiciel : principes et applications (McGraw-Hill, 1986), l’informatique a été inventée par des grammairiens et des linguistes (Alan Turing n’a-t-il pas été d’abord un mathématicien de très bon calibre et un cruciverbiste averti, si on en croit le film Imitation game réalisé en 2014 par Morten Tyldum ?). C’est un fait : l’informatique n’a pas été inventée par ceux que l’on appelle aujourd’hui des informaticiens.
Je pense que, le paradoxe est là : ce dont la France a besoin, ce n’est pas d’ « informaticiens qui parlent anglais », comme disait Claude Allègre, mais de techniciens, d’ingénieurs et de professeurs ayant de solides connaissances générales [*] qui maîtrisent la langue française. En reprenant les mots d’Ingrid Riocreux dans La langue des médias. Destruction du langage et fabrication du consentement (L’Artilleur, 2016) :
« Une langue bien maîtrisée par ses locuteurs, connue et estimée d’eux, avec ses subtilités de lexique, ses possibilités syntaxiques et ses difficultés propres, résiste d’elle-même à l’inflation de mots étrangers, en adopte parfois, en adapte souvent, mais endigue naturellement leur prolifération. » (Op. cit., page 29-30, c’est moi qui souligne).
Par contraposition, il en résulte immédiatement que la propension (consciente ou non) à se gargariser de termes anglais lors d’échanges avec des Français ou dans des écrits prétendument rédigés en français relatifs à l’informatique, la publicité, le journalisme ou la communication, est révélatrice d’un rapport sinistré à la langue française.
Dans la pratique que j’en ai, l’informatique n’est pas une fin en soi, mais un instrument au service des mathématiques et des statistiques, par le biais d’outils tels que LaTeX, R, Python, ou encore Sagemath.
Compléments philosophiques :
- Julia de Funès, Socrate au pays des process, Flammarion, 2017, dont on trouvera une présentation ici ;
- Jacques Carbou, La mécanisation de l’esprit, Édition du verbe haut, 2022.
[*] C’est en tout cas le point de vue de Yann Le Cun, dans sa conférence La théorie de l’apprentissage de Vapnik et les progrès récents de l’IA, donnée à la Bibliothèque nationale de France, dans le cadre du cycle Un texte, un mathématicien, organisé en collaboration avec la Société mathématique de France, à partir de 1 h 12 min 8 secondes.